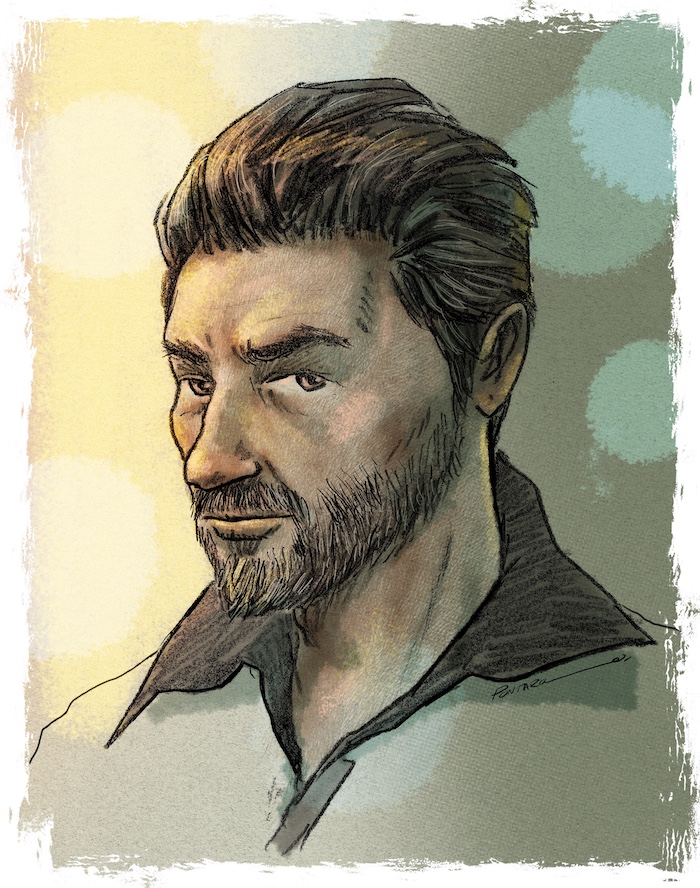Nathalie Quintane l’a exploré à sa façon avec : Que faire des classes moyennes ?
J’aime beaucoup ce livre. Moi quand je parle de l’individu moyen, je parle de moi sociologiquement et anthropologiquement parce que j’ai tout un tas d’identifiants qui sont la moyenne de notre pays, je suis blanc, je suis un mec, j’ai 48 ans, dans une zone sociale intermédiaire, mais qui n’est pas tout à fait la classe moyenne. Celle dont parle Nathalie et à laquelle elle s’en prend, c’est cette classe qui a toujours été au bout du compte du côté de l’ordre existant, alors que paradoxalement elle aurait pu être du côté des forces contestataires, elle a plutôt choisi d’épouser la cause de la bourgeoisie. Toute la tradition marxiste a toujours été perturbée par cette notion de classe moyenne, ça cassait le côté un peu binaire de prolétariat et de bourgeoisie, qu’est-ce que c’était ce truc au milieu qui en plus n’était pas souvent du bon côté, du bon côté de la barricade je veux dire. Ce qui, je crois, est en train de changer tellement elle est en train de se prolétariser et de rejoindre les Gilets Jaunes. Dans la pièce, nos amis sont d’une classe un peu supérieure, ils ont une piscine ! Et même si le fait d’avoir une piscine s’est un peu « démocratisé », on est là dans une bourgeoisie moderne, assez cool.
Une bourgeoisie cool ?
J’aurais dit à une certaine époque une bourgeoisie macronienne, mais ceux-là sont en train de devenir pas cool du tout. Il reste la devanture… Je parle d’une bourgeoisie aux options sociétales plutôt éclairées, plutôt ouvertes, qui est pour la PMA, qui n’est pas foncièrement raciste, très largement post-catholique. On a tous du cool en nous…
On vous a pourtant traité de stalinien.
C’en est presque flatteur ! « Stalinien », déjà cette expression, pff… C’est toujours très drôle de voir des gens s’agiter et de perdre leur discernement. Eh bien voilà, justement, je peux être cool dans la conflictualité sociale, je ne vais pas agresser les gens, je reste dans un espace plutôt pacifique. Regardez, ici même nous sommes dans un très beau hall de théâtre, les gens ne parlent pas trop fort, nous avons un échange très courtois. Dans Piscine(s), l’un des personnages, Paul, suite à un choc émotionnel fort, a tout d’un coup des envies de propos d’une brutalité presque primitive. Entre tous ses amis avec lesquels il a grandi, construit une piscine, avec qui il a fait affaire, joué au poker il dit à un moment : « Je viens restaurer la cruauté. » Il voit ces corps pacifiés qui n’ont plus aucun rapport avec la violence, ne sont-ils pas en train de se dévitaliser, de s’atrophier. Lui, il a envie de réveiller l’animalité primitive.
L’idée de la monstruosité est une forme nécessaire.
Si l’art n’a pas un rapport avec la violence, il est très vite exsangue. L’art, c’est prendre acte de la violence du monde, des choses et de la vie, à toutes échelles. Sans cela on reste dans une bulle.
La dernière pièce que j’ai vue c’était Retour à Reims. Si j’y pense, c’est que l’adaptation du livre de Didier Eribon m’a laissée songeuse, justement à cause d’un lissage émanant d’un certain théâtre qui se voudrait subversif. Mais je n’ai pas encore lu le livre qui est parait-il remarquable.
Je vais aller dans votre sens, enfin d’une certaine manière, parce que je pense que c’est un livre surestimé – mais moi je n’ai pas vu la pièce ! – sur l’analyse réelle de la sociologie intime, moi qui aime tant son croisement avec la psychologie sociale. Et je trouve qu’Eribon avait fait un travail beaucoup moins sérieux que je ne l’avais fait avec Deux singes ou ma vie politique qui va beaucoup plus au charbon dans le sens où Eribon n’explique pas vraiment son évolution à lui, sa famille d’origine ouvrière devenue Front National et sa propre généalogie intellectuelle et là-dessus il n’est pas sérieux. Comment passe-t-on du prolétariat à la haute culture, en tous cas à la recherche pointue, puisque Didier Eribon est un chercheur tout à fait éminent. Ni lui ni Édouard Louis, avec lequel il fonctionne beaucoup en binôme, n’ont fait un travail sérieux pour expliquer cette bascule sociale. Moi, c’est un sujet qui me passionne.
Vous êtes très vigilant quant au sérieux.
Je ne le suis pas dans la vie, mais je ne rigole pas avec l’écriture d’un livre, surtout avec un tel sujet, il faut s’éreinter à creuser. Comment un être devient ce qu’il est, pour moi c’est un sujet majeur. C’est le sujet. Sans avoir, comme Eribon, le culte du professeur et du savoir. Je ne crois pas qu’il suffise de rencontrer de bons profs pour que la culture apparaisse comme désirable et devenir un intellectuel. Chez lui, l’homosexualité a beaucoup joué, mais justement là aussi il ne creuse pas assez. Quand on annonce à ses semblables qu’on va penser devant eux, on a je crois un devoir de rigueur, il faut en avoir mal au crâne, mal au dos. L’art n’exclue pas la rigueur, mais permet la fantaisie. L’écriture théâtrale par exemple permet de ne pas penser tout ce que l’on écrit.
Vous croyez à l’énoncé de théâtre politique ?
Je n’ai pas grand-chose à ajouter à ce qu’a parfaitement, et dans un livre tout à fait industrieux, montré Olivier Neveux, Contre le théâtre politique. Ce qui porte le nom de politique en ce moment au théâtre ne l’est pas, c’est de l’édification morale, montrer tout ce qui est mal de dire, de penser et de faire. Les pouvoirs publics sont en forte demande, notamment depuis les attentats. L’injonction républicaine. Jacques Rancière appellerait ça la police. La police de la pensée, qui ne dit pas son nom. La pire. Alors que le théâtre politique c’est tout le contraire, c’est mettre sur le plateau la conflictualité, le dissensus. Dans Piscine(s), l’antagonisme est de nous à nous-même. Je suis très sensible, parfois, à la notion brechtienne de pièces didactiques, celles qui doivent faire réfléchir et déstabiliser le spectateur et faire trembler ses convictions.
Vous faites de l’entrisme en quelque sorte ?
J’ai plutôt eu de la chance au théâtre en me retrouvant dans des aventures qui se passent bien, Piscine(s) en est un exemple, personne n’est venu nous emmerder. De toute façon, c’est la grande affaire du théâtre depuis toujours, comment et jusqu’à quel point composer avec ceux qui vont financer. J’ai eu affaire, dans le théâtre privé à d’autres injonctions qui ne sont pas les mêmes, elles sont plus cash. Ce n’est pas mieux, mais c’est moins retord.
Le mot culture a quel sens pour vous ?
Je n’ai jamais décroché de la belle formule de Godard : « La culture est la règle, l’art c’est l’exception. » Nous sommes rares à organiser notre vie autour de l’art, ce sont des vies intempestives. Nous parlons beaucoup de ça avec Matthieu. Il va devenir de plus en plus bizarre de passer vingt heures de sa vie à lire Les démons de Dostoïevski ou L’homme sans qualité de Musil, ce sont des attitudes qui deviennent étranges.
Pourquoi avez-vous eu envie d’écrire Piscine(s) ?
C’était au moment où j’écrivais Histoire de ta bêtise qui portait sur la bourgeoisie comme classe sociale et j’avais envie de faire un truc plutôt sur l’anthropologie libérale, ce qui n’est pas la même chose, à savoir quel type de vie nous font avoir nos objets technologiques, nos travaux, les villes dans lesquelles on habite, qu’est-ce que ça fait à nos corps de marcher dans des quartiers piétons, ne finissent-ils pas par s’oublier dans ces espaces à coussins d’air ? C’est aussi à cause de ce rapport à l’espace que Matthieu a choisi de travailler avec la chorégraphe Cécile Laloy. Voir à quel point l’époque influe sur nos corps. Par exemple, dans les films des Frères Lumière, il y a cette raideur. Regardez mon corps, il est parfaitement libéral, c’est ça mon drame ! Et mon cerveau est marxiste !
Que représente pour vous le comble du luxe ?
L’art. Parce que pour l’obtenir il faut du temps, de la disponibilité, de l’esprit. J’aime l’aristocratie et la classe ouvrière, j’ai grandi en croyant à l’aristocratie ouvrière, qui existait et qui allait au théâtre. Après j’ai fait du punk-rock qui a toujours été pour moi une musique de l’aristocratie ouvrière, c’est-à-dire des gens des classes populaires qui s’accordent un luxe, celui de dire son refus d’aller à l’usine comme leurs parents et de préférer faire du punk. Que chacun ait l’arrogance de s’accorder le luxe de l’art, de la pensée et de la protestation. Ne laissons pas le luxe à nos classes dominantes qui en font un si mauvais usage. Le luxe matériel, c’est pour les “pauvres” gens qui ont des Rolex, ils sont tristes. C’est tellement plus beau quand on sent comment les corps populaires ont dévié de leur destin sociologique, de leur assignation pour s’octroyer quelque chose qui leur était interdit.
Punk, vous l’êtes toujours ?
Cette émotion-là ne m’a jamais quitté. La joie et la fraternité, parce que c’est là que ça se passe.